Exodus
By the rivers of Babylon[1]
Leonora Miano, Tels des astres éteints, 2008, Plon.
(et aussi en exclusivité, quelques remarques palpitantes sur Un sujet français d’Ali Magoudi, Assommons les pauvres de Shumona Sinha, Celles qui restent de Fatou Diome et Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye)
Je voulais faire un article court et drôle ; c’est raté. Faut dire qu’avec un pavé de Leonora Miano qui s’intitule Tels des astres éteints comme sujet, ça partait mal. Et qu’avec quatre cent pages de questionnements sur l’identité, l’immigration et le rapport à la terre natale, un de mes sujets de prédilection du moment, ça partait encore plus mal… Ne vous attendez donc ni à rire (après tout, c’est la fête des Morts aujourd’hui, pas celle des Rillettes et des Serpentins), ni à avoir un aperçu ultra-rapide et digeste de la littérature africaine aujourd’hui (le jour où je saurai faire court et simple, ça se saura (et puis le digeste après avoir parlé de rillettes, c’est encore plus mal parti)).
Pourtant le roman en soi n’est pas, à mon sens, un chef d’œuvre. C’est un beau roman qui entremêle les destins de trois personnages, « également » noirs (la question de l’égalité et de la noirceur pose, problème, d’où mes guillemets) : Amok et Shrapnel, issus de milieux complètement différents d’un pays d’Afrique sub-saharienne qui ressemble de près au Cameroun, se retrouvent autour de trente ans à Paris, où ils rencontrent Amandla, d’origine guyanaise (ce que Miano ne dit jamais explicitement d’ailleurs, mais tant pis pour le suspense haletant). Non, je n’ai pas fait de faute de frappe, enfin pas dans le prénom du moins, elle s’appelle bien Amandla, en souvenir du mot zoulou amandla signifiant « pouvoir » et rappelant le cri de revendication des combattants noirs pendant l’apartheid. Tous ont de graves problèmes d’identité, des histoires familiales compliquées qui ne sont pas résolues dans le roman par une bonne psychanalyse, mais par le récit d’engagements militants ou non dans la vie et la Cause noire. Le roman ne raconte en fait pas grand-chose, mais permet une plongée au cœur de trois cheminements, trois questionnements, trois rapports au monde et à l’identité. Suivant les méandres musicaux dont la bande-son est donnée à la fin de l’ouvrage, et qui permet d’accompagner les pensées des personnages, chaque chapitre tire son nom d’un morceau célèbre dans les cultures musicales « afro » que je ne connais pas du tout et dont je me garderai bien de parler (en ce qui concerne la musique, j’ai la culture qu’a mon fils de trois ans en physique quantique). Ensuite on suit les pensées des trois personnages, alternativement, en de longues pages qui épousent leur histoire, leurs errances et leurs doutes métaphysiques, sur lesquels il va bien falloir que je me penche une bonne fois puisque c’est le sujet de l’article – et accessoirement du roman dont je parle.
Je commence par Shrapnel, parce que c’est relativement simple : issu de la forêt équatoriale et élevé par sa grand-mère Heka dans un rapport évident aux éléments de la nature, et en particulier du fromager sacré, Shabaka, qui l’a vu naître, il est violemment chassé de cet éden à la mort d’Heka, et vit d’abord à la capitale où il rencontre Amok, puis à Paris, où il subsiste de petits boulots en petits boulots, et milite activement pour la Cause : une maison des cultures africaines, plantée sur le sol africain et appelée Shabaka en mémoire de l’arbre vital dont les racines plongent dans la terre africaine et qui nourrit un peuple. En dépit de son amour de la terre mère et de son engagement au sein d’une association communautaire, les Frères atoniens, qui prône une « africanité » radicale et assez raciste, il tombe amoureux d’une jeune femme blanche, Gabrielle, ce qui le pousse au conflit intérieur, mais aussi à la rupture avec ses compagnons atoniens.
Amandla est élevée par sa mère Victorine, rebaptisée Aligossi et imprégnée de la pensée de Marcus Garvey, mais aussi des penseurs rastas : retour à la Terre mère, détestation de Babylone, de ses pompes et de ses œuvres, unité des Kemites (le peuple noir issu d’Afrique) à travers le monde et l’histoire, recréation du monde à travers le retour aux racines et ses forces débordantes d’énergie. Sa foi et son engament se heurtent non seulement au racisme ambiant, souvent paré d’un attrait typiquement occidental pour un exotisme de pacotille, mais surtout aux divergences avec ses frères et sœurs kemites : entre ceux qui ne rêvent que d’intégration et se raidissent les cheveux avec obstination, ceux qui veulent bien militer pour la renaissance de l’Afrique mais préfèrent le faire de Paris, et Amok, qui la déçoit parce que ses propres démons l’empêchent de réaliser l’union mystique et cataclysmique qu’elle rêve, elle finit par décider de partir seule aux sources africaines, quand la maladie de sa mère la rappelle dans son propre pays natal.
Enfin, Amok est un personnage particulièrement intéressant, parce que plus lucide que ses amis, dès le début du roman : grandi dans une famille de « collabos » qui ai œuvré pour les colons puis assis sa fortune sur l’exploitation des frères, il fuit à paris où il n’est rien et tente d’oublier la violence du père et le gâchis de tout un continent dont il semble être le seul à comprendre les difficultés réelles, au-delà des utopies qui gouvernent ses amis. Malgré l’amour qu’il porte à Amandla, il ne parvient guère à s’ « engager » ni dans une cause, ni dans l’existence, et survit au jour le jour avec ironie et désespoir. Refusant de retourner dans un pays où son nom évoque irrémédiablement une caste sociale haïe, il ne s’intègre pas non plus à un quelconque mouvement, voyant les failles et la naïveté de ceux qui croient pouvoir sauver l’Afrique d’elle-même.
Ces trois personnages se heurtent donc à des contradictions : étrangers à leur pays d’origine et aux Français qu’ils croisent, ils cherchent à créer une identité noire qui n’existe guère, tant les différences de point de vue entre eux sont importantes ; pire, ils trouvent chez leurs frères un rejet de l’autre qui épouse précisément celui des Babyloniens qu’ils rejettent.
Si ce roman m’a plu, alors que je ne suis ni noire ni africaine, c’est pour deux raisons : d’une part, parce qu’il évoque une question qui m’intéresse depuis des mois, celle de l’immigration, et de la double appartenance à un pays quitté, souvent idéalisé ou fuit avec horreur, et à la France, terre d’asile (haha) dans laquelle l’identité de l’autre pose problème. Qui est-on en France si on n’adhère pas à un certain nombre de ses valeurs, de ses modes de pensée, de ses mœurs ? y a-t-il dans mon pays d’origine une place pour l’autre ? Comment vit-on ce déracinement ? les valeurs auxquelles je crois sont-elles un reflet de l’impérialisme idéologique ou ont–elles une valeur universelle ? Qu’attend-on d’un immigré qui s’installe en France ? D’autre part, le communautarisme noir, et plus particulièrement antillais, est une question qui m’intéresse depuis plus longtemps encore, depuis que j’ai rencontré celui qui serait mon mari et qui m’a plongée dans ces questions d’identité et de rapport au pays natal et à la couleur de peau, par ses positions, sa langue, ses amis, ses choix. Quand nous nous sommes connus, je ne m’étais jamais rendue compte que j’étais blanche – même en enseignant dans des établissements où il ne fallait pas me parler, parce que j’étais blanche- et je m’évertuais à décrire un Noir par des tas de qualificatifs sans jamais nommer sa couleur parce que je ne voulais pas la voir ; je considérais que c’était un point de détail, qu’on pouvait parfaitement reconnaître un individu à d’autres caractéristiques physiques. Bref, je niais absolument la couleur de peau, ce qui était d’une naïveté touchante. Les années m’ont appris que derrière ces regards portés sur les gens, il y avait des siècles d’histoire tourmentée que je ne pouvais effacer d’un simple revers de main, parce que c’était nier trop de souffrances et refuser, au fond, de regarder la réalité en face. Cette question est trop ancrée par des siècles de racisme et de pratiques ultra-violentes pour que par le seul effet d’une volonté d’égalité totale, on ne la respecte pas un minimum. Bref, je m’égare, mais ce roman m’a touchée aussi parce que le problème y est clairement posé : est-ce que la couleur de peau dit quelque chose de la personne qu’on voit ? bien sûr que non pour moi ; mais peut-être pour l’autre. Ce n’est pas parce que, en tant que blanche, je ne me suis jamais posé la question de la couleur, que l’autre ne se la pose pas. Ce jeu de regards est particulièrement mis en avant par Leonora Miano, qui évoque le rejet d’Aligossi par ses parents, parce qu’elle était la plus noire de la fratrie, et l’interrogation quant à sa fille plus claire parce que son père était quarteron (terme ignoble qui évoque les races canines et désigne un subtil métissage ; terme typique d’une société esclavagiste qui non seulement a existé pendant longtemps, mais régit encore les types physiques par tout un vocabulaire qui est encore usité). Au départ, ça m’a profondément choquée, qu’on parle de sa couleur, qu’on se voit noir ou blanc ans une glace ; surtout que ce n’était pas spécialement le cas du jeune homme que je fréquentais, et que je trouvais certains de ses amis particulièrement communautaristes. Puis j’ai lu plein de trucs : beaucoup de littérature antillaise et haïtienne, un peu de littérature africaine aussi. Et puis discuté avec plein de gens, visité la Guadeloupe, commencé à comprendre que nous avions grandi dans deux mondes totalement séparés, que si j’écoutais béatement Nirvana dans les années 90, c’était pour une vaste partie du monde « de la musique de blancs » à laquelle on préférait du rap et de la dance hall. Je trouvais que c’était une richesse pour tout le monde que les DOM soient restés des départements français, et qu’il aurait fallu enseigner la littérature francophone partout en France, et pas seulement aux Antilles. Et puis j’ai visité Antigua cet été en lisant L’imaginaire des langues de Glissant, je me suis rendue compte que de minuscules îles de la Caraïbes pouvaient parfaitement être indépendantes et cultiver les accordes commerciaux qui lui plaisaient sans que son économie s’effondre et qu’une dictature s’installe immédiatement ; que surtout, en cessant de compter sur un état qui maintient une situation malsaine d’assistanat et de dépendance réciproque, les peuples pouvaient sortir de l’aliénation et construire leurs propres modèles. Bref, je vire indépendantiste, et pourtant ne suis pas acquise à la « cause noire » telle qu’elle s’illustre chez les frères atoniens de Tels des astres éteints.
Au fond, les valeurs que je porte sont-elles universelles comme je le crois ou cette idée d’universalité est-elle le déguisement de Babylone pour mieux contrôler les autres peuples ? Je me pose souvent cette question parce que je suis trop perméable aux idées d’autrui, trop influençable, que je comprends trop bien les points de vue des autres, en général, pour être tout à fait sûre de mes propres idées. (Attention, risque aigu de dissertation prétentieuse à venir ! sautez ce paragraphe si vous êtes épuisé d’avance). Si l’égalité de droits, la liberté, la laïcité, la fraternité me semblent difficilement attaquables au fond (bon, sur la laïcité on peut en débattre mais là j’ai la flemme) ce qui pose problème réside dans les moyens mis en œuvre : le modèle démocratique est sans doute ce qu’on a trouvé de mieux jusqu’à présent (mais à vrai dire je n’en connais pas tant que ça) mais l’imposer par la force, agrémenté du mythe du progrès par le capitalisme le plus effréné, c’est évidemment plus discutable. Au nom de l’universel, n’enseigner qu’une langue et laisser les autres se réduire à peau de chagrin, c’est juste idiot : il suffit d’enseigner autant de langues qu’il y en a de parlées (et allez, que je vous refais la politique internationale des langues en trois coups de cuillère à peau : mais pourquoi ne suis-je pas embauchée par l’Unesco ?). A cet égard, je pense que Glissant, justement, est plus optimiste que les puristes de la Fraternité atonienne qui enseignent à leurs émules le medu neter et le méroïtique, langues des anciennes civilisations de l’Egypte pharaonique : il explique que si les métissages créent de nouvelles langues sur les racines des langues actuelles (les termes été expressions camerounais qui jalonnent le discours d’Amok en sont d’excellents exemples, car ils inventent une langue qui emprunte au français, à l’anglais et à d’autres idiomes africains pour exprimer une réalité propre au pays réel), il y aura autant de nouvelles langues ainsi créées que de groupes qui partagent une même réalité ; en d’autres termes il ne voit pas dans le métissage la mort des peuples différenciés mais la naissance d’autres communauté en réseaux.
C’est justement contre tout métissage que se battent les frères atoniens (et dans une certaine mesure, Amandla), au nom de la préservation de leur identité. Mais cette identité existe-t-elle réellement, alors qu’ils ne parlent que le français, puisque beaucoup d’entre eux ‘ont jamais mis les pieds dans leur « pays natal », et que c’est justement la seule langue qui leur permet de s’entendre, et celle du colonisateur honni ? Ces individus issus de tous horizons, que seule unit leur couleur de peau et leur appartenance supposée au peuple kemite qui apparaît comme un mythe, voire un leurre, quelle est leur réelle identité ? c’est dans le rejet des Blancs et de leurs « valeurs » qu’ils s’unissent. On a le droit de se bâtir « contre », c’est même souvent salutaire et indispensable. Mais les personnages du roman ne parviennent pas à se satisfaire de cette identité fictive, dans la mesure où leurs contradictions personnelles les ramènent à d’autres déterminations : goûts sexuels ou musicaux, milieu social, qualités intellectuelles… or ces valeurs individualistes sont précisément celles prônées par les puissances nordistes au détriment de la « communauté » qui ne peut plus les satisfaire. Ils veulent donc préserver une identité qui n’existe guère, à travers un langage qui n’est plus parlé depuis des millénaires, mais ne veulent à aucun prix retourner en Afrique, où ils se heurteraient à la réalité d’une grande indifférence à l’ égard de ces théories nébuleuses : les racines sont ils se glorifient sont coupées, et il faut les replanter, sur place, comme décide de le faire Amandla, pour espérer un quelconque changement.
Pourtant quels sont ceux qui rentrent au pays, après leurs études, ou porteurs de forces nouvelles ? Si ce n’est les fils de bonne famille qu’on attend pour pérenniser la société de classe calquée sur les pires aspects de l’ex-puissance coloniale. Pour beaucoup, rentrer au pays natal c’est justement se confronter avec un certain obscurantisme qu’on a laissé avec dégoût ; pour Amok, par exemple, il est hors de question de revivre l’inégalité d’un pays dans lequel le brillant mais pauvre Charles-Bronson, sorti de nulle part, n’obtient pas de bourse pour aller étudier à l’étranger et retourne à la charrue, alors que lui, nettement moins bon, mais bien né, peut aller fréquenter les meilleures universités étrangères. Pour Shale, amie d’Amandla, fréquenter des hommes noirs, tous plus misogynes et brutaux les uns que les autres, est simplement impensable : si la jeune Guyanaise explique leur ineptie par l’aliénation qu’ils subissent depuis des siècles, et qui leur impose d’eux une image de pitre ou de mâle puissant, jamais d’homme, son amie refuse simplement de se mêler à ses « frères », et plus encore de revenir fonder un empire qui n’a jamais été unifié, et dans le mythe duquel s’abîment et se perdent des individus en quête de dignité.
Leonora Miano met en scène cette quête de dignité, d’identité, d’unité qui caractérise ses trois personnages, et à travers eux, une certaine génération d’immigrés en France, nés après les grandes luttes nationalistes ou panafricaines, et qui cherchent dans la « communauté » refaite en France une réponse à la non-existence que leur oppose un système peu propice à l’intégration des différences. Je sais bien que c’est un sujet sensible et que je risque de me faire quelques ennemis, mais il me semble que si le ton de ce roman est si sombre et sa fin si cruelle pour Shrapnel, et incertaine pour Amok et Amandla, c’est aussi parce que le rapport au pays natal et à celui d’adoption reste problématique. Un Camerounais en France peut se définir comme un Camerounais, avec toute l’ambiguïté que cette étiquette lui colle ; au Cameroun, il n’est ni un Français, ni tout à fait un Camerounais ; et dans les deux pays, il n’est jamais défini pour ce qu’il est réellement, pas même au sein de sa propre communauté (l’exemple de la tribu d’appartenance à l’aéroport est très parlante à cet égard), mais pour des critères qui lui sont extérieurs, et par rapport auxquels on exige pourtant qu’il se détermine : origines, classe, couleur de peau… Il me semble donc que ma touchante ingénuité peut agacer : ne pas vouloir voir la couleur de peau est justement un luxe qu’on ne peut connaître que parce qu’on est de la même couleur que la majorité d’une population, ou que de toute façon, on porte la couleur qui assure la tranquillité à peu près n’importe où.
Du coup, promis, au prochain épisode, je parle (plus rapidement, n’ayez crainte) des autres livres sur la question) !
[1] Petite anecdote marrante (si si je suis une nana hyper drôle, je vous jure !) sur cette chanson de Boney M, grâce à laquelle j’ai trouvé une idée géniale en prépa sur un poème imbittable de Quevedo : me rappelant la chanson, j’ai pu retrouver le psaume dont s’inspirait le poète espagnol, et compris un aspect ES-SEN-TIEL du sonnet ! Qui eût cru que se trémousser sur de la disco (sans rien, mais rien savoir sur Boney M ni la Bible à l’époque) à seize ans me donnerait une idée brillante à 19 sur un sonnet obscur de Quevedo… Enfin je n’ai pas été jusqu’à citer mes sources, j’avais l’air suffisamment cruche comme ça en cours pour ne pas en rajouter.

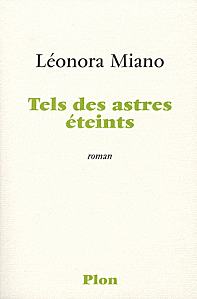





/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F28%2F90%2F856625%2F90522386_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F58%2F23%2F856625%2F80671645_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F7%2F4%2F742811.jpg)