Désorientée
« Quand j’étais petite, je vivais au Liban, et c’était la guerre. »
C’est par ces mots que débutait le devoir d’une élève, sommée de « raconter un souvenir d’enfance marquant », en préambule à une séquence sur l’autobiographie. Cette première phrase m’avait profondément émue, au point que je me souviens, des années plus tard, de ce rythme ternaire, de ces mots simples, de la pudeur, surtout, et de l’incapacité à dire la nostalgie douloureuse d’un pays que cette jeune fille avait connu, et tenté d’oublier. Parler d’un moment dramatique, et plus encore quand il ne nous appartient pas en propre, relève de la gageure : il faudrait être un grand écrivain pour en honorer la mémoire, en rendre l’émotion, car si l’on ne trouve pas la voix la plus juste, on ne fait que salir la mémoire, et il vaudrait mieux se taire.
Se cantonner à ne parler que de soi, c’est réduire la littérature à la somme limitée de ses petites expériences personnelles et c’est aussi, je crois, un peu vain. A l’occasion de cette séquence sur l’autobiographie, je m’agaçais d’ailleurs en coulisses de cette tentation narcissique par excès de modestie à ne voir du monde que son nombril. En ce qui me concerne, toute écriture à la première personne me renvoie à mon propre vide, à mon absolue insignifiance, et au silence. Mais s’emparer de la vie des autres (quelque imagination que l’on ait, on finit toujours par revenir au réel, pour éviter précisément ce vide, cette froideur de l’exercice de style), requiert un respect, et surtout un talent, que je n’ai ni n’aurai jamais. Car à raconter l’instant fatidique d’un deuil, d’un exil, de la naissance d’un amour ou de celle d’un espoir, on ne peut se permettre l’excès, l’indécence, le mauvais goût, la faute de ton qui rabaisse l’être dont on s’inspire à n’être qu’un personnage grotesque et pitoyable. S’ils nous touchent assez pour motiver la nécessité d’écrire leur histoire, la pudeur et le respect se heurtent à l’incapacité du mauvais écrivain à trouver la phrase juste, l’image la plus pure et son rythme inhérent.
Je ne parlerai pas davantage de ma propre honte de ne pas parvenir à cette juste convenance, j’en ai déjà trop dit. Mais je m’attacherai à la manière dont trois auteurs fort éloignés les uns des autres évoquent leurs blessures et celles de leurs proches, lors de la guerre du Liban : dans la pièce Littoral (première partie du Sang des promesses) de Wajdi Mouawad, dans le roman Les Désorientés d’Amin Maalouf, et enfin dans le film d’animation Valse avec Bachir d’Ari Folman, le conflit libanais est la toile de fond sur laquelle s’inscrit un drame personnel. Et chacun d’eux, avec les moyens qui lui sont propres, parvient à faire surgir la douleur du passé, la perte d’un pays aimé et de parents, d’amis perdus, par une mise à distance salutaire.
Dans les deux premières œuvres, un homme rentre au pays de sa jeunesse, le Liban, pour enterrer un rescapé de ce passé tragique, et se heurte à sa propre tragédie personnelle. Dans Les Désorientés, Maalouf donne la parole à un narrateur qui est aussi historien, double sans doute à maints égards de l’auteur lui-même. Mais son récit à la fois du voyage de retour au Liban, à l’occasion de l’enterrement d’un ami de jeunesse, et des chemins qu’ont pris tous les compagnons de jadis, est entrecoupé de lettres de ces vieux amis, de récits d’anciens dialogues, de longs messages, dans lesquels chacun prend la parole et dit son histoire, sa vérité, son rapport au pays et au passé, à l’amitié et à la loyauté. Que reste-t-il des rêves communs, des idéaux partagés à vingt ans quand la guerre a fissuré jusqu’aux valeurs les plus profondes qui unissaient ces êtres ? La mort de Mourad, qui a « trahi » ses amis par une attitude haïssable et de multiples compromissions pendant le conflit, mais est resté fidèle à sa terre natale en refusant de quitter le pays, quitte à s’y salir les mains, pousse chacun des anciens amis à une introspection. La dramatisation s’effectue par ces allers-retours permanents entre le point de vue d’Adam, le narrateur, qui atteint la cinquantaine, et ceux des anciens amis qu’il retrouve, et qui racontent leur parcours, mais aussi entre le présent et les multiples strates du passé qui les unit et les sépare à la fois : s’efforçant d’organiser des retrouvailles, Adam confronte des paroles antagonistes, comme pour résoudre par les discours et la distance permise par le temps un conflit qui porte en germe, selon l’historien Adam, tous les maux du siècle, et explique les rapports complexes de l’Orient et de l’Occident. En effet, ce qui met à distance l’émotion et permet de comprendre en profondeur ses enjeux, c’est moins la pudeur de ces hommes et femmes mûrs à l’heure d’évoquer leur jeunesse diffuse, que la mise en perspective historique. A mesure que les souvenirs personnels affleurent, les regrets et les déceptions, les vieilles rancunes et les affections jamais démenties, Adam s’efforce de travailler à la biographie d’Attila, autre figure d’un destin qui mêle l’orient et l’Occident dans une tragédie commune, et pose la question de la barbarie[1], et se trouve confronté à un grave problème d’écriture, qui met en abyme tout le roman. L’historien reconnu se refuse à écrire des choses trop personnelles, et se cramponne au discours analytique, distancié, du savant ; mais il ne peut s’empêcher à l’occasion de ce retour de coucher par écrit ce qu’il ressent, et est envahi d’une forte gêne face à ces phrases impudiques, personnelles, frivoles en somme. Le roman réussit le tour de force de laisser s’exprimer cette parole intime et de lui donner envergure et profondeur par la mise en perspective historique que la confrontation des analyses d’Albert, Naïm, Adam lui-même offrent à l’œuvre. A travers leurs discours mêlés, leur histoire d’amitié prend en effet une dimension historique complexe, ambiguë, puisque chacun y va de son interprétation, et profondément humaine, puisque les postures politiques et historiques s’incarnent à travers des destins singuliers et des personnalités attachantes.
Dans sa pièce de théâtre vibrante, nerveuse et toute en tensions, Wajdi Mouawad prend à bras-le-corps la question du retour au pays natal et du deuil[2]; pas le sien, mais celui du père de Wilfried, qui meurt au début de la pièce, et que son fils décide d’enterrer au Liban. Outre la dramatisation évidente, deux procédés me semblent particulièrement intéressants ici : le recours au mythe d’une part, et l’image autour de laquelle se construit la pièce d’autre part, le cadavre du père que porte un fils dans ses pérégrinations. Tout d’abord, pour évoquer ce rapport au père dont le fils sait trop peu de choses, et dont pourtant il porte un lourd héritage, le dramaturge convoque et mêle deux mythes, non sans humour : Hamlet et le fantôme du roi qui rappelle à son fils le devoir de vengeance, Œdipe qui porte en lui la culpabilité de l’avoir tué et les rapports ambigus qu’évoque la scène où Wilfried, en plein acte sexuel, apprend la mort de son père, et a ainsi l’impression abominable d’avoir violé son propre père, et cette transgression initiale s’accompagne d’une culpabilité qui le pousse à entreprendre avec sa sœur le voyage insensé dans un Liban dévasté par la guerre, devenu un vaste cimetière. Les êtres qu’il rencontre appartiennent à la réalité du pays autant qu’au fantasme : le chevalier rappelle au jeune homme le poids de son devoir, mais Hakim, Amé, Wazaân sont autant de voix tragiques qui disent un pays déchiré par des factions ennemies. L’absurdité de cette quête est renforcée par l’humour noir, souvent sordide et grinçant : le cadavre finit par tuer, manière de dramatiser l’action alors qu’on ne trouve nul havre de paix pour l’enterrer et avec lui oublier ce passé toujours aussi puissant aux narines des protagonistes. Mouawad dit ainsi à travers la violence verbale et les images de la scène une impossibilité de se débarrasser des fardeaux qu’on hérite : l’origine, la faute, la violence. Le traumatisme est mis en scène à travers les disputes des personnages : le père, cadavre un peu bavard, est tué une seconde fois, mais la présence sur scène de son corps laisse imaginer l’importance symbolique de l’héritage qu’il laisse à son fils malgré lui : ce dernier, né en France d’une mère française, fait tout pour s’en débarrasser au plus vite, mais il est tenu par une forme de loyauté qui le dépasse, et en cela son errance sur les littoraux libanais est empreint d’un profond sentiment tragique, en dépit de la farce macabre du spectacle. Le mélange de grotesque et de tragique contribue à la mise à distance nécessaire de l’expression de cette déchirure intime, qu’est l’héritage d’une guerre qu’on n’a pas vécue et le sentiment de trahison de l’exilé face aux siens, que Maalouf exprime aussi parfaitement à travers les dialogues entre ceux qui sont restés et ceux qui ont quitté le pays.
Littoral, mis en scène par W. Mouawad au festival d'Avignon, 2009 (?)
Enfin, Ari Folman raconte la guerre du Liban et ses traumatismes vue par un jeune soldat israélien, et emploie deux procédés passionnants pour ressusciter le souvenir : d’une part, il se met en scène en tant que réalisateur, à la première personne, cherchant dans ses rêves, ses rencontres avec les compagnons de jadis, ce qui peut expliquer une image récurrente : la psychanalyse lui permet de reconstruire peu à peu la scène qu’il avait oubliée, parce qu’elle lui était insupportable : il a assisté et s’est rendu complice malgré lui du massacre de Sabra et Chatila, dans lequel des milliers de civils, femmes et enfants principalement, ont été massacrés par la milice chrétienne de Saad Haddad, avec l’aide et la complicité des forces israéliennes. Ari retrouve un à un ceux des anciens compagnons qui sont encore en vie, et lui racontent leur propre guerre, qui se reconstitue pour lui en épisodes successifs pour prendre sens peu à peu, et lui permettre de passer de la réminiscence d’un cauchemar, celui des chiens enragés qui le poursuivent, à la réalité de l’histoire vécue, à la profonde culpabilité éprouvée alors. Ce détour psychanalytique s’accompagne d’un détour par le dessin : tout le film est ait à partir d’un procédé technique original, qui consiste à reproduire en images d’animation des images réelles filmées : au risque d’ailleurs de me tromper sur le procédé technique, l’effet créé est celui d’un dessin animé qui se surimpose à l’image filmée, ce dont témoignent les gestes et expressions très cinématographiques des personnages. Le détour par le dessin, très réaliste et en même temps stylisé, épuré, s’estompe soudain à la fin du film, quand Ari se rappelle enfin la scène du massacre : au dessin se substitue le film d’actualité, la réalité crue. On voit des cadavres d’enfants et des mouches. Du sang, des corps mutilés. On entend des hurlements et l’ensemble est tellement insoutenable qu’on a le réflexe de se détourner de l’écran. C’est exactement le processus psychologique qui a permis au jeune soldat israélien de ne pas devenir fou : le recours à une image qui a pour but de signifier la fiction, l’irréalité, la construction mentale pour éviter l’horreur vécue et sa part de culpabilité.
De ces trois œuvres, qui traitent parmi tant d’autres d’un conflit sanglant et particulièrement traumatisant, qui n’a pas été directement vécu par les auteurs, soit qu’ils soient partis en exil plus tôt, soit qu’ils aient participé très indirectement au conflit, comme c’est le cas d’Ari qui découvre sa part de responsabilité bien moins importante qu’il ne le croyait, plusieurs points attirent mon attention. La question du détour : toutes trois passent par des détours, des images ou des procédés stylistiques signifiants, par un léger décalage du point de vue, une mise en fiction de la réalité, pour l’affronter et en extraire du sens dans le magma des émotions douloureuses. Toutes trois aussi trouvent un ton juste, inhérent au sens qu’elles transmettent : la distance historique de Maalouf, la mise en scène d’un homme et de ses fantômes chez Mouawad, les images du rêve et l’histoire d’une psychanalyse chez Folman, contribuent à éclaircir le sens caché d’une histoire personnelle dans laquelle, avant que de l’écrire, on est empêtré par la violence de ses émotions.
Mais il s’agit dans cet article, avant tout, d’évoquer la loyauté, et l’honnêteté de l’auteur par rapport à la réalité, qu’elle soit « sienne », si tant est qu’elle puisse n’être qu’à soi, ou qu’il l’ait empruntée à quelqu’un d’autre. Au début de cet article, j’ai évoqué la trahison, parce que je crois que raconter la vie de quelqu’un sans avoir le talent d’en rendre l’intensité, l’enlaidir en somme, est un acte de trahison, et pourtant peut-être inévitable. Si j’ai parlé des Désorientés, c’est aussi parce que le roman parle de la loyauté aux amis du passé et à soi-même, et de l’honnêteté intellectuelle à laquelle croit Adam et qui le pousse à réunir tous les anciens, en dépit ou justement à cause de leurs positions inconciliables, pour discuter, créer une possibilité de dialogue. Au fond, ce que je crois, c’est que je ne sais pas répondre à la question « comment ne pas trahir ceux dont on s’inspire ? » et que la seule manière dont je pourrais y répondre, c’est d’écrire un récit qui mette en scène les rapports de l’écriture avec la réalité. Je crois commencer à comprendre comment certains s’y prennent pour mettre la distance suffisante face à la réalité la plus intense, celle devant laquelle on n’a pas de mots, mais je ne sais pas encore comment m’inspirer d’une réalité sans la profaner, en mettant la juste distance qui donne sens sans détruire, en suscitant l’émotion sans la blessure, en honorant l'autre sans le déposséder.
[1] P. 348 : Adam à Sémiramis : « Attila, c’est moi, comme aurait dit Flaubert.(…) C’est l’archétype de l’immigré. On lui aurait dit : « Tu es citoyen romain ! » il se serait enveloppé dans une toge, il se serait mis à parler latin et serait devenu le bras armé de l’Empire. Mais on lui a dit : « Tu n’es qu’un barbare et un infidèle ! » et il n’a plus rêvé que de dévaster le pays. (…) ça aurait pu être mon cas, et c’est certainement celui de beaucoup d’immigrés. L’Europe est pleine d’Attilas qui rêvent d’être des citoyens romains et qui finissent par se muer en envahisseurs barbares. Tu m’ouvres les bras, je suis prêt à mourir pour toi. Tu me refermes ta porte au nez, et ça me donne envie de démolir la porte de ta maison. »
[2] Le retour au pays natal et el rapport au père sont intrinsèquement liés, et finissent par constituer un topos de la littérature de l’exil, à l’image du très beau livre de Dany Laferrière dont j’ai déjà parlé ici, L’Enigme du retour, et aussi, d’une autre manière, dans les récits de Pierre Bergounioux, comme La Toussaint et La Maison Rose.

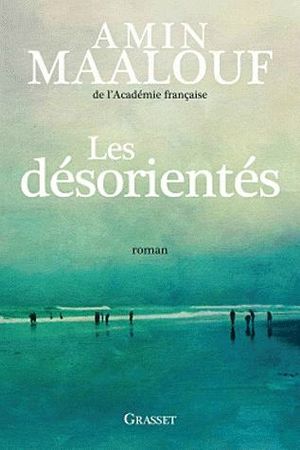

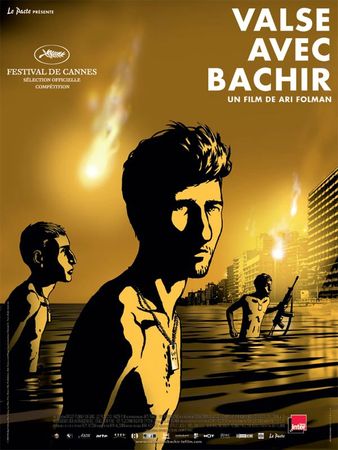

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F42%2F84%2F856625%2F90794131_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F59%2F91%2F856625%2F83936389_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F28%2F90%2F856625%2F90522386_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F7%2F4%2F742811.jpg)