littérature féminine et rapports de force
Le bon, la brute et la femme
La question féminine est un sujet de choix pour explorer les rapports de force à l’œuvre dans une société, et la littérature contemporaine ne se prive pas de s'y plonger. Plus la société en question est machiste, plus les femmes y sont soumises aux hommes, enfonçons une première porte ouverte. Mais ce qui est intéressant est le lien que ces analyses sociales permettent de tisser entre autoritarisme politique et machisme familial ou social. Les femmes apparaissent comme des créatures empêchées, sur lesquelles s’exerce une violence révélatrice d’une autre forme de violence, entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles, entre ceux d’un clan dominant et leurs victimes. Quelques exemples puisés dans mes récentes lectures, d’horizons franchement hétérogènes, le mettent en évidence : dans Le meilleur reste à venir, roman nigérian de Sefi Atta, la narratrice, jeune fille de bonne famille, relate tout ce qui peut arriver à une femme dans son pays, du viol à la prostitution de luxe, de la servilité envers un puissant protecteur à la rue, de la soumission conjugale des filles bien mariées aux tromperies les plus fourbes qu’elles subissent de maris qui ont tous les droits, et notamment celui de fonder plusieurs familles en parallèle, sans qu’on n’y trouve à redire: de l'humiliation de la tache du sang menstruel au drame de l'infertilité, toutes les vicissitudes de la condition féminine sont évoquées, pour dénoncer une injustice sociale révoltante. Outre la narratrice, victime de la trahison de son amant Mike et de la révélation que son père a eu quatre enfants d’une autre femme que sa mère, est racontée la vie de son amie d’enfance, Sheri, issue d’une famille plus modeste, musulmane, dont la mère et les deux coépouses se retrouvent sans un sou pour nourrir leur nombreuse progéniture quand le père vient à décéder et que son frère rafle tout son héritage, coutume musulmane oblige. A travers le destin des deux femmes, et de celles qu’elles rencontrent, Sefi Atta raconte la violence sociale qui sévit dans un pays marqué par des injustices insupportables, où les riches paradent dans des quartiers de luxe pendant que les misérables s’entassent dans d’interminables bidonvilles, rongés par les maladies et la misère, soumis à tous les aléas d’une existence de parias. La violence de cette société est sans cesse rappelée parle climat politique : guerre civile au Biafra dont on entend à peine parler dans la capitale, coups d’état successifs et enlèvements, emprisonnement des opposants et couvre-feu arbitraire sont la toile de fond des aventures sentimentales, professionnelles et familiales des deux héroïnes. La deuxième partie du roman, à cet égard, est la plus intéressante, quand la narratrice est installée comme avocate et ayant à peu près réglé ses déboires amoureux, se heurte de plein fouet à l’injustice qui sévit dans le pays, alors qu’elle-même connaît les lois et tente de les faire respecter. D’une part, aux lois officielles en vigueur s’oppose la coutume (qui concerne essentiellement les familles musulmane et qu’on appellerait la charia, si je ne m’abuse, mais les commentaires sont faits pour rectifier les inexactitudes), contre laquelle la pétulante avocate ne peut pas grand-chose, et à laquelle son amie choisit de souscrire lorsqu’elle se fatigue de se battre contre l’ordre social, en revenant dans le giron familial. D’autre part, la courte expérience de la prison à laquelle elle est contrainte, pour avoir assisté à une simple réunion de soutien aux détenus politiques, dont son père fait partie, lui donne un aperçu saisissant des bas-fonds de sa ville à travers les femmes avec lesquelles elle partage, moins d’une nuit, sa cellule. Ces femmes sont l’image lépreuse et souffrante d’une misère sociale et surtout de l’injustice qui frappe le pays, et dont elle-même malgré toutes ses protections, est victime, et leur dégradation physique et morale, la crasse ignoble, la maladie, la folie de cette cellule surpeuplée représentent en quelques pages l’enfer de tout un pays dont la narratrice est protégée par son milieu social et son aisance financière. Mais tous les personnages féminins qui jalonnent son parcours disent la même injustice : femmes bafouées, violées et soumises à des hommes toujours vainqueurs, elles illustrent la violence des rapports de force dans un pays où l’on ne circule pas, quand on a de l’argent, sans escorte, où l’on se bat pour survivre dans une véritable jungle où tous les coups sont permis, et les victimes les femmes et les enfants.
Autre contexte, et autres rapports de force sociaux, dans L’Autobus, d’Eugenia Almeida, roman argentin tellement loué par la critique que je n’ai plus grand-chose à dire dessus, si ce n’est qu’un épisode a retenu mon attention en ce qu’il révèle comme rapports insidieux entre montée au pouvoir des putschistes et soumission féminine. Ponce, avocat du bourg où l’on attend interminablement un autobus qui ne s’y arrête pas, quatre jours d’affilée, et notable local imbu de son propre pouvoir, est pourvu d’une femme qu’il a épousée suite à un malentendu tragique, et dont il a décidé de se venger en lui faisant vivre un enfer. Jeune fille prude et extrêmement discrète, bien née et encore mieux élevée, Marta s’est donnée à lui contre toute attente un soir, contre le mur d’une usine, comme une prostituée, parce qu’elle a eu pitié de sa solitude et de sa tristesse. Il apprend quelques semaines plus tard qu’elle est vraisemblablement enceinte, et lui offre de l’épouser, par sens de l’honneur, bien que personne ne sache rien de cette grossesse. Elle refuse d’abord l’offre par orgueil, puis s’y résout pour éviter un drame familial, et peu après ce mariage sans amour, fait une fausse couche, alors que nul ne la savait encore enceinte, si ce n’est Ponce qui décide de la faire payer pour ce mariage qu’il n’a jamais souhaité, et qui s’avère d’autant plus absurde : il l’emmène dans le bourg le plus reculé du pays, l’enterre vivante dans une pension sinistre, et la laisse livrée à elle-même en regagnant le plus souvent possible la capitale, où il règle ses affaires. L’existence sordide à laquelle il la contraint lui permet d’assouvir une vengeance personnelle : elle l’a pris en pitié, et l’a contraint à l’épouser, elle paie ce double affront à son honneur de mâle, et de mâle dirigeant. Dans le roman, Eugenia Almeida ne met pas directement en rapport ce personnage avec le climat de violence civile qui règne peu à peu dans le bourg, où les autorités de Buenos Aires tentent de prendre une subversive échappée en bloquant toutes les issues et en enfermant toute la population dans la solitude et la suspicion ; mais que viendrait faire l’histoire de l’avocat et de sa femme, personnages finalement assez secondaires dans la trame générale du récit qui met en scène l’isolement du village et le début de l’enfermement d’un pays dans la dictature de Videla, si ce n’est donner à lire une certaine histoire de l’Argentine, dans laquelle les victimes sont figurées par ces femmes qu’on soumet, dont on brise jusqu’à l’humanité, la volonté de résister, et qui deviennent des folles bavardes comme des canaris enfermés en cage ? A travers l’histoire de Marta, son enfermement progressif dans la solitude accablante d’un village où chacun épie son voisin, où la ligne rouge du rail sépare les gens comme il faut de la plèbe, se lit ainsi une forme de violence sociale, historique : la jeune fugitive qui a tenté de quitter le village est rattrapée et tuée dans le wagon de train où elle avait trouvé refuge, et seule sa robe blanche permet de l’identifier sur les photos, tant son sang et ses blessures l’ont défigurée. Incarnant en cela l’implacable violence de l’ordre autoritaire, le mari a réduit sa femme à l’exécution d’une pantomime vaine, un peu frivole, masquant la réalité de sa souffrance, de son abandon, de la mort précoce de son enfant et avec lui de tous ses espoirs de bonheur. Une image du pays entier et de ses façades bourgeoises impeccablement lisses et minées de l’intérieur par les tortures, disparitions et exécutions sommaires qu’on s’efforce de nie pendant de longues années. La violence, ce n’est pas frapper sa victime, du moins pas seulement : c’est faire d’elle une chose inerte qui ne se plaint pas d’être frappée et s’efforce de maintenir l’apparence d’humanité quand elle n’est plus qu’un amas de chairs brisées. C’est l’aliénation à laquelle est soumise Marta, et qui l’empêche à tel point de se révolter que ses parents ne devient jamais ce qu’est sa vie de femme mariée, non plus que Victoria, la sœur de Ponce, qui tente de protéger les subversifs et quitte le village sans avoir soupçonné un instant ce qui se tramait entre son frère et sa belle-sœur.
Mais qu’en est-il dans des sociétés plus démocratiques, où règnent l’égalité des sexes et une certaine paix sociale, où du moins l’on essaie de tendre à une certaine idée de la justice ? Laissons là toutes les illusions à cet égard, et plongeons-nous dans le noir : Audiard pour le film Sur mes lèvres pour la France, Ledesma pour le roman policier Cinq femmes et demie pour Barcelone. Par ce choix, une petite remarque s’impose: c’est dans l’univers peu aseptisé du polar que les rapports sociaux et en particulier la place des femmes sont mis en scène pour montrer l’envers du décor : la violence qui règne dans des sociétés apparemment policées, bien sous tous rapports, justes et égales en droit etc. Comme s’il fallait un crime pour qu’on s’intéresse aux arrière-cours, aux pièces de derrière, aux doubles vies des ex-taulards et des petites secrétaires sans histoires. Sordide. Car l’univers de ces deux auteurs est justement assez sordide pour qu’on puisse s’en sentir assez éloigné pour ne pas être remis en cause de façon trop brutale dans nos petites habitudes, je présume.
Le roman noir de Francisco Gonzalez Ledesma met en scène un policier raté, Mendez, réputé n’avoir jamais mis la main sur un coupable sans l’avoir laissé filer ou castagné, qui enquête sans en avoir l’air, en traînant dans les cafés de son quartier et els arrière-cours, sur des affaires qui semblent n’avoir guère de lien entre elles : tout commence par l’assassinat de Palmira Canadell et celui de son principal agresseur, mais à mesure que le vieux flic rencontre d’autres femmes qui fréquentent le café des poètes de la ville, parlant d’un tournage publicitaire qui devrait enfin les sortir de la misère, il entrevoit la vie de chacune d’entre elles, et les relations inattendues qui les lient : Patricia Cano, maîtresse de deux hommes riches et puissants, est l’amie d’Eva Ferrer, veuve d’un avocat qui peine à joindre les deux bouts et parlemente longuement avec l’un de ces hommes autour de l’affaire du tournage, et du montage financier qu’il y a derrière la construction d’un lotissement de luxe sur ses anciens terrains. Les histoires s’entremêlent et permettent de peindre des portraits de femmes poursuivies à la fois par des mâles violeurs, prédateurs, qui ne rêvent que des les sauter, de « la leur mettre bien profond » ou de les suspendre aux anneaux de leurs gentilhommières sordides pour mieux les humilier et les baiser, les rendre choses au sens propre, si l’on peut dire, et par la peur de la misère. Femmes déchues ou nées dans le ruisseau, elles sont toutes, à l’exception de Marta Pino et de Sonia Vera, respectivement sœur et femme de ces deux mâles puissants, des proies que l’on tient par l’argent, car elles en manquent, et ont des enfants à élever ou un prestige à sauvegarder, ou une telle habitude de l’humiliation qu’il ne leur vient même plus à l’idée d’y résister, comme Patrica Cano, violée avec la complicité de sa mère dès son plus jeune âge par les clients réguliers de cette dernière, qui faisait pour sa part ce qu’elle voulait pour ne pas tomber dans le ruisseau après la disparition de son mari. Il y a certes des vengeurs, des protecteurs de la veuve et de l’orphelin dans le roman, de Mendez au tueur Reglán ou au révolutionnaire Pedro Anselmo, qui veut épouser Eùma Canadell pour la protéger et tenir la promesse faite à la mère de cette dernière par sa propre grand-mère, dans une geôle franquiste, plus de soixante ans plus tôt : mus par le sens de l’honneur, ces hommes-là se contre-foutent des lois au profit d’une justice plus lapidaire et entière. Car face à eux, ces nobles personnages doivent se battre contre de véritables enflures, qui cumulent la force physique, et celle du fric. La prostitution et le viol sont les deux conséquences directe de cette domination masculine, aussi bien sociale que physique dans le monde noir du polar : soit la femme se soumet et on la dédommage financièrement, en l’aliénant, soit elle refuse, et on la force. Quitte à la tuer si elle résiste un peu trop, comme c’est le cas de plusieurs victimes dans le roman : Palmira Canadell, mais aussi Helena Bustos qui se pend en recevant la lettre qui lui indique que son ex-mari, grâce à sa nouvelle épouse richissime, a obtenu la garde de leur fille en dépit des violences conjugales exercées à son encontre, et aussi d’une certaine manière la femme de la photo, qui meurt debout sous les coups des franquistes, exhibant son con comme ultime signe de résistance à la violence sommaire des hommes, car avec cela elle donne à voir la force des femmes, celle d’enfanter l’espoir au plus fort de la tourmente. En effet, à la force brutale des hommes, qui figure aussi une société où l’argent donne tous les droits, où la justice n’a de juste que le nom et profite aux puissants, aux riches et à ceux qui ont le culot de menacer un juge, s’oppose un autre type de force, celui des femmes. Celles qui gagnent le pactole à la fin du roman sont précisément ces femmes délaissées ou humiliées, qui n’ont courbé l’échine et accepté certaines compromissions, ou au contraire lutté becs et ongles pour conserver leur dignité vaille que vaille : elles ont monté une très grosse affaire leur permettant de se partager les gains réalisés sur le dos des bourreaux d’hier, Oscar Madero en tête, grâce à un jeu subtil et une machination particulièrement rusée. Cette force des faibles s’incarne à travers le jeu sur les jumelles, Emma et Palmira, dont la dernière est indomptable et invincible, alors que la première est d’une douceur qui l’expose à toutes les violences ; mais les rôles se renversent à deux reprises, ce qui est moins une pirouette de roman policier sachant ménager les effets de surprise qu’une image très intéressante de la complexité des rapports de force entre hommes et femmes dans ce livre. Les virils protecteurs s’avèrent eux-mêmes relativement inutiles face à la détermination des femmes qu’ils essaient de sauver : si leurs interventions musclées sont salutaires, elles n’en sont pas moins dotées de ressources étonnantes qui montrent un possible retournement de ce rapport de force très favorable à la phallocratie ambiante. Aux machines à plaisir que constitue le corps féminin vu par des hommes qui calculent la dose de plaisir à l’aune de la finesse des cuisses ou de la volupté des seins, s’oppose une intelligence machiavélique, une sensibilité et une générosité à fleur de peau incarnés par les personnages d’Eva Ferrer, Anna Parra, dévouée aux enfants des autres ou la troublante Patricia Cano, qui n’est pas seulement une « petite putain », mais la victime d’un destin sordide, et dont la rencontre avec Reglán émeut profondément le lecteur : l’amour impossible entre les deux personnages, la capacité d’amour de la jeune femme encore inaltérée en dépit des horreurs vécues derrière les rideaux rouges, est l’image d’une capacité féminine à espérer toujours, et à prodiguer cet espoir aux autres, dans un monde où ces valeurs sont limitées à l’attente d’une faillite ou d’une affaire juteuse. L’engagement très social de ce roman contribue à donner aux femmes un rôle essentiel : à travers leurs histoires mêlées de sang et de sperme sale, de deuil et de violences, c’est une certaine image de l’Espagne qui se donne à lire : le personnage d’Oscar Madero l’illustre parfaitement. Obèse et jouisseur sadique, il se plaît à poursuivre ses proies dans les couloirs de son palais de Sodome et à les fouetter pour leur rappeler leur nullité, et écrase sa digne épouse pendant de longues heures de tout son poids, jouissant de sa suffocation et de son pouvoir dominateur sur un corps désirable, qui est réduit à l’état de carpette dont toute idée et tout sentiment est exclu par la position de planche qu’il lui fait subir. Ce promoteur véreux est aussi un salaud qui a déclaré son entreprise en faillite, pollué abondamment les alentours de son usine de textiles et licencié en masse ses salariés, sans compensation évidemment, pour se lancer dans des affaires encore plus mirobolantes : il ne règne que par l’écrasement des autres, au propre comme au figuré. La corrélation entre l’injustice sociale et la violence masculine, profondément machiste, dans un pays qui se prétend civilisé et progressiste en la matière donne à réfléchir ; certes l’Espagne est un pays culturellement machiste, ce qui n’est évidemment pas le cas de la France, où l’égalité règne tellement que les masculinistes sont en train de révéler le fond trouble de leur pensée, où tous les jours des Juges des Affaires familiales et des experts psychiatriques remettent à de malheureux pères des enfants dont ils ont abusé et qui ont été indument privés de leur droit de visite par des mégères acariâtres et castratrices. Parenthèse close.
Le vrai pouvoir des femmes, et celui des faibles en général, je crois que nul mieux que Jacques Audiard ne sait en parler avec autant de finesse. Son film Sur mes lèvres, sorti en 2002, met en scène une secrétaire vieille fille dans un bureau de promoteurs immobiliers, justement, à croire que c’est le métier qui regorge le plus d’infâmes salauds dans la fiction française, où elle se fait quotidiennement humilier par ses collègues : on pose sa tasse sur son bureau comme si elle n’était pas là , on commente sa vie sexuelle inexistante à grands renforts de gestes grossiers à la cantine, on lui retire ses dossiers au dernier moment parce que « de toute façon elle est incompétente », on va jusqu’à lui proposer un assistant parce que toute seule, ben elle a du mal, quoi, c’est une cruche… en plus, elle est sourde et appareillée, ça n’aide pas. Même sa bonne copine se sert d’elle à longueur de temps en lui fourguant sa fille pour s’aller s’envoyer en l’air, et l’engueule très fort quand elle ose ne pas être à sa disposition : bref, trop bonne trop conne (encore une expression, du reste, qu’on utilise essentiellement au féminin, parce qu’en plus d’être « bonnes » à tous les sens du terme, les femmes qui le sont trop sont nécessairement bonnes : dans le genre rapport de forces à la con…). Jusqu’au jour où son assistant, ex-taulard, arrive dans le bureau et qu’elle l’affecte aux photocopies, espérant le grand amour et se heurtant à l’indifférence du garçon, qui n’est pas franchement disposé à jouer les grands amours romantiques avec une secrétaire mal baisée. Elle a bon cœur et elle l’aime bien, alors elle l’aide, trop : elle va jusqu’à lui donner les clés d’un appartement en travaux, pour l’aider à se réinsérer. Et en parallèle, elle fantasme seule et en silence, et comme elle n’est pas franchement baisante elle est d’autant plus ridicule, à poil en talons hauts dans sa chambre, à se regarder devant son miroir. Et le sommet est atteint quand il croit qu’elle attend de lui une récompense d’ordre physique, et qu’il s’apprête à la violer, et s’éloigne devant son air offusqué. Mais subrepticement les rapports de force changent. D’abord, elle fait un peu de chantage à l’ex-taulard, en le menaçant de le mettre à la porte s’il ne l’aide pas à voler le dossier d’un collègue peu scrupuleux qui lui a piqué les siens au dernier moment. Puis elle lui demandera un petit coup de main, un peu d’intimidation face à de mauvais payeurs, pour se faire bien voir de son chef et regagner un peu d’estime des autres. C’est de bonne guerre. Mais quand Paul replonge, doit payer une dette en travaillant dans la boite de nuit glauquissime d’un type louche et menace de quitter son travail à ses côtés, Carla montre toute l’ambiguïté de leurs rapports de force : elle accepte de l’aider dans une sombre affaire d’escroquerie, grâce à sa capacité à lire sur les lèvres, à condition qu’il continue à travailler sous ses ordres. Ainsi, elle a à la fois un statut professionnel, puisqu’elle passe de la bobonne de service à la petite chef qui donne des ordres à un subalterne, et la satisfaction de voir cet homme, dont elle est amoureuse, avec elle nuit et jour. En échange de quoi, elle l’accompagne dans la banlieue lointaine pour passer ses nuits, gelée, jumelles vissées aux yeux, à essayer de comprendre ce qui se trame dans un appartement en haut de la boîte, lui prête sa voiture, passe chez lui prendre des fringues de rechange, et se met en danger avec des individus peu recommandables. Acceptant de faire tout le sale boulot, elle manque se faire violer, pénètre par effraction chez le patron de la boîte, un truand prêt à tuer tout ce qui lui tombe sous la main, arrive à délivrer Paul par ruse quand l’affaire tourne mal, alors même qu’elle vient de découvrir qu’il comptait partir sans elle au bout du monde une fois l’affaire terminée. Bonne poire, elle l’est moins qu’il y paraît pourtant : d’une part, comme Audiard l’avait déjà montré dans Regarde les hommes tomber, il y a dans l’absolue soumission à l’autre une forme de pouvoir exercé sur lui, une espèce de redevance trouble qui s’instaure, et qui n’est pas tout à fait absente du couple de Marta et Ponce dans L’Autobus : à force de se soumettre à la volonté de l’homme, la femme crée avec lui un attachement fait de culpabilité, de plaisir d'être admiré et aimé, de gratitude gênée qui peut aller jusqu’à la haine, mais qui lie les personnages qui se détestent à mort et veulent s’infliger des souffrances morales plus étroitement que ne le ferait l’amour. Cette soumission absolue, aveugle, canine, crée en outre une proximité entre les personnages qui suscite entre eux le désir. A force de se voir sans cesse, d’être complices dans la noirceur de leurs actions nocturnes et diurnes, qui finissent par se confondre, de partager les mêmes draps par commodité et camaraderie dans le crime, le désir naît entre Paul et Carla, à l’opposé de la première tentative maladroite de Paul de sauter sa chef pour la remercier de l’appartement. Enfin, la force féminine qu’incarne Carla dans cet univers de brutes épaisses, où les femmes se font baiser et jeter, où on leur dit « prends des cachets et fous-moi la paix » quand elles dérangent leur mari ou qu’on les met au placard dans un bureau de petits cons machistes, se manifeste par une ténacité, une détermination et une abnégation aussi absolues que leur apparente soumission. Carla accepte tout, en dépit des humiliations et déceptions qu’elle subit de la part de Paul, qui n’est pas amoureux d’elle et la traite avec dureté (mais au moins une certaine égalité, un peu d’homme à homme en comme). Elle s’accroche : ce qui dans la vie courante est une faiblesse ridicule, qui met mal à l’aise, qui peut confiner à la folie, donne au contraire au personnage la force de commettre des actes illégaux, dangereux, et de s’en tirer avec beaucoup de courage. Personnage lucide, Carla se sait amoureuse de Paul et prête à tout pour parvenir à ses fins : le rendre amoureux d’elle. Quitte à s’abaisser, à se laisser humilier, alors même que tout bon traité d’éducation amoureuse rappelle l’importance de traiter de haut ceux qu’on veut soumettre. Mais au-delà de ces clichés à la « fuyez-le, il vous suit » dont regorgent les magazines féminins, Audiard fait le pari de raconter comment l’amour et le désir naissent au contraire non pas du combat de deux orgueils un peu superficiels, mais d’un rapport de force entre soumission et brutalité, indifférence et instrumentalisation. Dans ce film d’une sensualité torride, où Carla devient de plus en plus troublante, où l’on suit son regard plein de désir sur les bras et les mains de Paul et ceux de ce dernier sur la secrétaire coincée qui finit par se libérer d’un étau en nageant dans l’univers du crime, les rapports de force entre l’homme et la femme, la manière dont cette dernière réussit à prendre sa revanche sur un environnement de domination virile, où les « vertus » féminines comme la douceur et la bonté sont systématiquement discrédités comme synonymes de faiblesse, en utilisant précisément ces qualités-là comme des armes pour se rendre indispensable.
Je trouve vraiment intéressantes ces manières de mettre en scène la question des rapports entre hommes et femmes au cœur, plus vaste, des rapports de force dans une société : la violence de ces fictions, plongées dans des univers très noirs, ceux du crime ou de la dictature, illustre surtout la violence subie par les plus faibles dans des sociétés qui restent profondément injustes, et notamment par les femmes, qui continuent, même en France, à cumuler le plus fort taux de chômage, par exemple. Mais ce que disent ces fictions, c’est aussi la force des faibles, le retournement possible du rapport de force, la terrifiante force de la douceur, de la faiblesse et de la sensibilité. Ces qualités n’ont peut-être de féminin que des années de culture machiste et d’éducation sexiste, car il est évident qu’il existe autant de femmes impitoyables que d’hommes sensibles ; mais à travers ce jeu de renversements des rapports de force, se lit bien sûr la dénonciation des violences toujours exercées sur les femmes, autant sur le plan physique que sur le plan moral et social, et une réflexion sur le pouvoir et ses manifestations modernes : soft power contre violence classique. Ce qui ne laisse pas d’inquiéter, mais c’est une autre histoire…



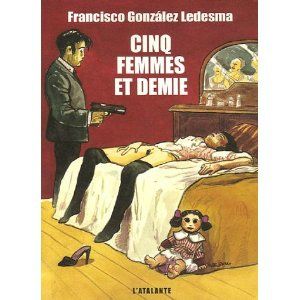


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F42%2F84%2F856625%2F90794131_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F74%2F856625%2F88218462_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F25%2F856625%2F86967342_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F59%2F91%2F856625%2F83936389_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F7%2F4%2F742811.jpg)