Fétiches et tabous
Albertine disparue à Istanbul
4 août 2011
Le Musée de l’Innocence, d’Orhan Pamuk, traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy, éditions Gallimard, 2011
Le récit d’une passion amoureuse, celle du narrateur Kemal, jeune homme fortuné, pour la belle Füsun, parente pauvre éloignée de sa famille, se déploie au long de plus de six cent pages, le cours d’une existence toute entière soumise aux aléas de la passion, et peint ainsi une certaine image du bonheur, comme le conclue l’histoire, en marge de toutes les attentes du genre. Lorsqu’il la revoie après des années d’oubli, Kemal va acheter un sac pour sa fiancée Sibel, jeune fille de bonne famille occidentalisée, dans la boutique où Füsun est vendeuse. Dès lors, pendant un mois et demi, les rencontres quotidiennes entre les deux jeunes gens vont remplir la mémoire de Kemal de souvenirs intenses et d’objets apparemment insignifiants auxquels ils sont rattachés, jusqu’à sa fête de fiançailles avec Sibel, au cours de laquelle il danse une dernière fois avec Füsun, invitée par ruse, et qui disparait le lendemain. Pendant l’été qui suit, Kemal prend la mesure douloureuse de cette disparition et de l’amour qu’il éprouve pour la jeune fille, sans pour autant arriver à se libérer de son engagement avec la sage Sibel, ne pouvant se résoudre à abandonner ses rêves de bonheur conjugal, de respectabilité, et de respect des normes sociales. A ce moment du roman, on pourrait se croire dans une intrigue comme celle de Match Point, de Woody Allen : déchiré entre le rêve de normalité sociale auprès d’une femme intelligente et appartenant à la meilleure société et la passion sensuelle pour une femme de basse extraction qui le anéantit sous ces rêves, le héros voudrait avoir la femme et la maîtresse, disposer de tous les plaisirs en gardant à sa disposition les deux univers incompatibles : mais la maîtresse amoureuse exige davantage, poussant le héros dans ses retranchements. Dans Le Musée de l’Innocence, pourtant, Kemal n’assassine pas Füsun, mais pense à elle si douloureusement qu’il finit, à cours de mélancolie, par rompre ses fiançailles avec Sibel, déshonorée, qui s’exile quelque temps à Paris. Quand Kemal retrouve enfin la trace de Füsun pour lui annoncer qu’il peut l’épouser, cette dernière s’est mariée avec Feridun, jeune réalisateur sans talent. Mais la tante Nesibe, la mère de la jeune fille, lui assure que ce mariage ne tiendra pas, et lui offre de venir dîner en famille aussi souvent qu’il le souhaite : suivront huit années de soirées partagées avec Füsun, parfois avec son mari qu’apprécie Kemal, sous l’œil vigilant des parents. A l’issue de ces interminables fiançailles, la jeune femme finit par divorcer et s’apprête à épouser le patient Kemal, alors que chacun d’eux a l’impression d’avoir raté sa vie : lui, par cette longue attente, la faillite de son entreprise et le déclassement qui s’en sont suivis, elle parce que ni Feridun ni Kemal, en dépit de leurs promesses, n’ont fait d’elle une star de cinéma comme elle le souhaitait ardemment. Au moment où les amants de naguère se retrouvent enfin, Füsun se lance à toute volée dans un platane en voiture, finissant broyée comme Grace Kelly dont elle aurait tant voulu imiter le destin : Kemal se retrouve à jamais seul, et entreprend de visiter tous les musées du monde pour en ériger un dédié à sa passion : il a collecté au cours de ces neuf années des milliers d’objets qu’il exposera dans l’ancien appartement de la famille où il a dîné si souvent.
Ce roman est placé sous l’égide du cinéma, et l’échec de Füsun et Kemal réside essentiellement dans ce qu’ils passent leur vie à attendre d’être les héros d’un film qui ne sera jamais tourné. Le rapprochement qui s’ébauche pendant l’été 1976 entre Kemal et Feridun prend ce prétexte : le jeune mari de Füsun espère que Kemal financera ses projets de films d’art et d’essais dont Füsun sera la vedette, alors que le mécène s’y engage, mais enrage de l’attitude cupide de sa bien-aimée, puis de son impatience, quand les scénario de Feridun sont examinés par la Commission de Censure, et de sa déception quand c’est la jeune Papatya qui devient célèbre grâce aux rôles qui lui ont été refusés et que son amant lui a refusé d’interpréter par jalousie. Si Kemal finance abondamment les films plutôt mauvais de son « rival », c’est finalement pour sceller une entente masculine autour de l’enfermement de Füsun dans une vie retirée, loin des projecteurs et de la concupiscence des autres : Kemal paye pour que Feridun assouvisse sa passion et lui laisse la voix libre pur occuper le foyer de la jeune femme. Cet arrangement exacerbe le ressentiment de Füsun, et explique sa rage suicidaire des dernières pages, seule moyen d’échapper une fois pur toutes à cet enfermement amoureux que Kemal lui offre en devenant à son tour une héroïne de film dramatique. Quant à Kemal, son destin est celui du producteur, qui agit dans l’ombre pendant que les personnages s’agitent en surface, et sa vocation d’anti-héros est sensible aussi à cette position. Pourtant, les descriptions de la jeune femme sont particulièrement cinématographiques, et c’est au cœur du roman même que la jeune femme devient une icône, le point de mire fascinant de toutes les scènes :
« Tandis que, d’un œil, je regardais le fil, j’observais de l’autre la façon qu’elle avait de remuer sur son étroite chaise de bois, de respirer, de fumer sa cigarette, de croiser ses jambes serrées dans un blue-jean pendant qu’Orhan Gencebay clamait « Malheur à qui est frappé d’un tel destin ! », et je m’amusais à essayer de deviner dans quelles proportions elle était émue par ce qu’elle voyait à l’écran. Au moment où la chanson d’Orhan prenait des accents de révolte contre ce mariage forcé avec Müjde-Seher, je me tournai vers Füsun et lui souris d’un air mi-tendre mi-moqueur. Mais elle était si absorbée par le film qu’elle ne m’adressa pas un seul regard. » (p. 338)
Le film passionne le spectateur dans la mesure où il trouve des correspondances entre le mélodrame vécu par les personnages et sa propre histoire qu’il partage avec Füsun, et surtout ce qu’il livre au regard du lecteur est le reflet du film sur l’héroïne de son propre récit, et la beauté qui se dégage de cette figure absorbée dans le spectacle. La mise en abyme permet ici de porter un « regard mi-tendre mi-moqueur » sur sa propre passion mais surtout de porter sur Füsun un regard : si sa vie est « brisée », selon le titre d’un fil dans lequel elle aurait dû jouer, c’est aussi parce qu’elle assiste en spectatrice aux vies trépidantes que donne à voir le cinéma turc, empêtrée dans une société qui laisse peu de liberté aux femmes et aux amants, et c’est en cela que ce roman est réellement tragique. Alors qu’elle regarde le spectacle d’une vie qu’elle ne vivra pas, la jeune femme n’adresse pas même un regard à l’homme qui l’aime, et qui assiste spectateur à la fascination de la jeune fee pour uen vie d’illusions telle qu’il ne pourra jamais la lui offrir. « L’amour est une chose impossible dans un pays où hommes et femmes ne peuvent se côtoyer, se fréquenter et discuter ensemble […]. Et tu sais pourquoi ? Parce que dès qu’une femme s’intéresse à eux, les hommes lui sautent dessus comme des bêtes affamées, sans faire de détails. C’est ancré dans leurs habitudes ; ensuite, ils prennent cela pour de l’amour. Comment l’amour pourrait-il exister dans de pareilles conditions ? » s’exclame tante Nesibe.
En effet, cette histoire d’amour est tragique parce qu’elle se déroule dans un contexte qui en empêche la réalisation pleine et entière : la religion et les traditions, surtout, ligotent les jeunes gens dans des convenances cruelles. Si Füsun s’est dépêchée d’épouser Feridun, c’est parce qu’elle a offert sa virginité, trésor sacré, à Kemal sans être mariée ; de même Sibel, quoique riche et très occidentalisée, est déshonorée car chacun sait qu’elle a eu des relations sexuelles avec son fiancé avant le mariage, avant même les fiançailles, et qu'elle a vécu avec lui plusieurs mois avant leur séparation. Malgré les airs affranchis qu’elle se donne, elle est comme toute femme turque des années 1970 soumise à un regard implacable sur ce qu’il convient de faire en matière de sexualité. Le cas de Nurcihan et Mehmet est très intéressant à cet égard : la jeune femme a eu des relations sexuelles en Europe où elle a fait ses études, et à ce titre, elle intimide Mehmet, qui pourtant fréquente avec assiduité les bordels stambouliotes et ne saurait renoncer aux plaisirs de la chair alors même qu’il est gêné par la liberté de la jeune femme. Ce cas est significatif de la schizophrénie qui régit les affaires de l’amour et du sexe dans la société turque post-kémaliste : malgré une certaine tolérance dans les milieux les plus occidentalisés, on méprise les femmes qui n’ont pas su conserver leur virginité jusqu’au mariage, rêvant d’une pureté féminine illusoire alors même qu’on s’adonne à tous les plaisirs de la luxure avec des femmes qu’on n’épousera jamais. Après cette « faute » consommée avec délectation au printemps 1975, les deux amants subissent en quelque sorte l’épreuve de la patience et de la loyauté, puisqu’ils se côtoieront pendant huit ans presque quotidiennement sans jamais pouvoir consommer leur passion, regagnant ainsi en quelque sorte l’honneur mis à mal par leur court moment de bonheur. Dans la légende arthurienne d’Erec et Enide, le chevalier Erec est déshonoré par l’amour qui l’attache à Enide et l’écarte des aventures et valeurs chevaleresques. La jeune femme, pour rendre son honneur à son compagnon, accepte alors de l’accompagner en chevalerie, et même d’avancer devant lui pour écarter de son bien-aimé les dangers du chemin, tout en se taisant absolument pendant tout le voyage. Ainsi seulement elle permettra à Erec de regagner l’honneur du chevalier et de concilier cette valeur avec l’amour qu’ils se portent. Le Musée de l’Innocence rejoue en quelque sorte cette dichotomie entre un bonheur sensuel et égoïste, qui isole les amants des conventions sociales et les coupe du monde, et la nécessité de regagner par une longue patience et des privations l’honneur perdu, afin de vivre enfin leur passion au cœur de la société ; échec dont témoigne la mort violente de Füsun, comme si la société dans laquelle elle vit avait privé de tout sens le bonheur qu’enfin elle peut atteindre après trop de souffrances, comme si l’amour et les codes sociaux régissant l’honneur notamment étaient vraiment inconciliables.
Ce sont ces codes et ces contraintes qui donnent à l’amour des personnages, pourtant, une richesse profonde : car ne pouvant aller à visage découvert, l’amour se faufile avec subtilité derrière des regards, des gestes, des intonations et des discussions anodines. Il est un moment où les deux amants se retrouvent dans la salle à manger un peu à l’écart, devant la cage du canari Citron, et les quelques mots qu’ils échangent (l’oiseau a-t-il assez à manger ? faut-il nettoyer sa cage ? a-t-il bien chanté aujourd’hui ?) permettent à Kemal de ressentir l’état d’âme de Füsun, ce qui décidera du ton de la soirée. Leurs conversations ornithologiques se poursuivent aussi dans la pièce du fond, où Füsun garde les dessins d’oiseaux qu’elle réalise et montre à Kemal : si les quels mots échangés restent parfaitement audibles par toute la maisonnée, leur caractère intime au cœur même du foyer où Kemal est accepté avec naturel parce que l’impossibilité d’une liaison intime est telle qu’il peut passer cinq heures par jour avec la jeune femme sans que rien de fâcheux ne se produise, donne à ces rapides entrevues un caractère profondément heureux. Le contexte de cette passion donne poids et sens à chaque soupir, chaque regard de la bien-aimée : ses sourires comme ses bouderies, ses regards et chacun de ses mots permettent au jeune homme de situer sur la Carte du Tendre l’avancée ou les reculs de sa passion : reprenant les tours et les détours de l’amour courtois, les amants traversent des épreuves qui devraient les mener au bonheur, mais un bonheur réduit à quelques fragiles instants.
Un élément particulièrement significatif à la fois de l’attention amoureuse portée au dérisoire, du fétichisme mélancolique du narrateur et de la modernité du roman-musée réside dans la place accordée aux objets, de préférence les plus insignifiants : tasse dans laquelle Füsun a bu lors de sa première rencontre avec Kemal, chiens en porcelaine posés sur la télévision familiale, feuilles du calendrier, boucles d’oreilles et notes de restaurant constituent les objets entreposés dans le « musée de l’innocence » et portés à l’attention du lecteur-visiteur, car dans chaque chapitre l’un d’eux sert de fil narratif. Ce fétichisme est l’un des symptômes de la mélancolie du narrateur, qui tente de saisir et de s’approprier quelque chose de l’autre à mesure que cet autre lui échappe. Dans Albertine disparue, Proust met en scène la souffrance de l’absence de l’être aimé ; chaque instant passé sans Albertine laisse dans le narrateur un manque que souvenirs et objets tentent de combler, alors même qu’ils ne font que renforcer l’absence. L’objet que l’autre a touché, regardé, objet témoin de l’amour, en devient la trace palpable qui cristallise l’essence de l’autre disparu et restaure pour le narrateur la Présence presque mystique de l’être aimé. « Bref Albertine n’était, comme une pierre autour de laquelle il neigé, que le centre générateur d’une immense construction qui passait par le plan de mon cœur. Robert, pour qui était invisible toute cette stratification de sensations, ne saisissait qu’un résidu qu’elle m’empêchait au contraire d’apercevoir. » Dans ces lignes de Proust, la construction mentale du narrateur autour de l’absence de la jeune femme est invisible aux yeux du témoin, seulement sensible aux objets dérisoires que le narrateur ne voit pas, car il perçoit en eux l’histoire entière de son amour. Les choses sur lesquelles s’appuie le souvenir sont imprégnées de la sensualité à laquelle le narrateur n’a pas droit ; d’après la théorie de Freud, le fétichisme sexuel résulte d’une forme de remplacement du pénis manquant chez la femme par un objet qui le remplace et viendrait d’une angoisse enfantine de la castration. Avec réserve, on pourrait alors imaginer que la « castration » dont souffre Kemal qui ne peut que respirer le même air que Füsun sans plus jamais lui faire l’amour est le résultat des contraintes sociales qui pèsent sur le couple. Ce culte des objets résidus de l’aimée finit par donner lieu à un musée, un livre, mais aussi un tombeau : le Musée de l’Innocence, comme Albertine disparue, est un livre de deuil : presque sept cent pages pour faire le deuil de Füsun, deux fois perdue, et dont les liens avec le narrateur, parce qu’ils ne résident plus que dans sa pensée, ont besoin d’objets extérieurs à lui pour être rappelés à la mémoire, pour être prouvés à la face du monde. La très longue chronique de la passion pour Füsun s’attache à faire revivre chaque soupir, chaque détail pour la ramener à la vie avant d’en faire définitivement le deuil. Le narrateur décrit les facéties de la pendule familiale, rapporte les paroles coutumières de tante Nesibe et Tarik Bey, les parents de Füsun,chaque soir devant la télévision, le temps qu’il fait et les cigarettes fumées par sa belle dont la fumée suit les méandres du temps. Tout rappeler pour ne pas laisser sombrer dans l’oubli celle qui a déjà péri en sa jeunesse et dont nul autre ne saurait célébrer la grâce : telle est la mission que se donne le preux Kemal, dont l’existence heureuse finalement trouve sens dans cette entreprise folle. Le chapitre intitulé « 4213 mégots » est particulièrement émouvant à cet égard. Le narrateur contemple ces reliques avec émotion et regret, et interprète dans ces pauvres restes l’essence même de la jeune femme :
« […] la forme de chaque mégot de cigarette résulte de l’extériorisation d’un sentiment éprouvé avec force par Füsun pendant qu’elle l’éteignait. Par exemple, les trois mégots que j’ai récupérés dans le cendrier de Füsun le 17 mai 1981, premier jour du tournage de Vies brisées au cinéma Peri, me rappellent la façon qu’elle avait de se replier et de se renfermer sur elle-même mais aussi de ne pas aborder la question et de faire comme si de rien n’était. »
Ainsi, l’être aimé se tapit tout entier dans chacun des objets qu’il touche et qui suppléent de leur mieux l’absence causée par la mort. Le regard attentif et sensible de Kemal redonne donc vie à cette femme qui est toutes les femmes aimées, toutes les femmes perdues, et toutes les amours déçues. Car si le roman de Pamuk évite le mélodrame qu’il évoque à travers le cinéma turc des familles, c’est qu’il se plonge dans le genre du roman d’amour avec une sensibilité et une forme de sincérité absolues : de jalousie en crises de mélancolie, le lecteur suit Kemal dans tous les méandres de sa passion, et souffre avec lui d’une longue attente dont rien ne nous est épargné, car ce réalisme des sentiments, des objets, de la répétition des jours et de leur légères variations que l’amour dramatise à outrance donne à cette histoire la grâce qui nous touche. Cet amour est éprouvé par tous les sens et dans tous les états d’âme du narrateur, à travers ses déambulations tristes ou rêveuses dans Istanbul. La mélancolie dans laquelle baigne tout ce livre-musée de deuil offre surtout un hommage vibrant aux amants qui savent vaincre obstacles et regards du monde, regagner l’honneur perdu par une constance et une loyauté à toute épreuve.

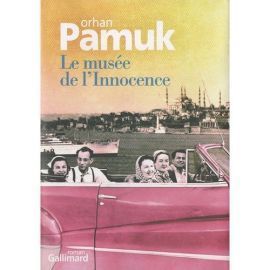





/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F7%2F4%2F742811.jpg)